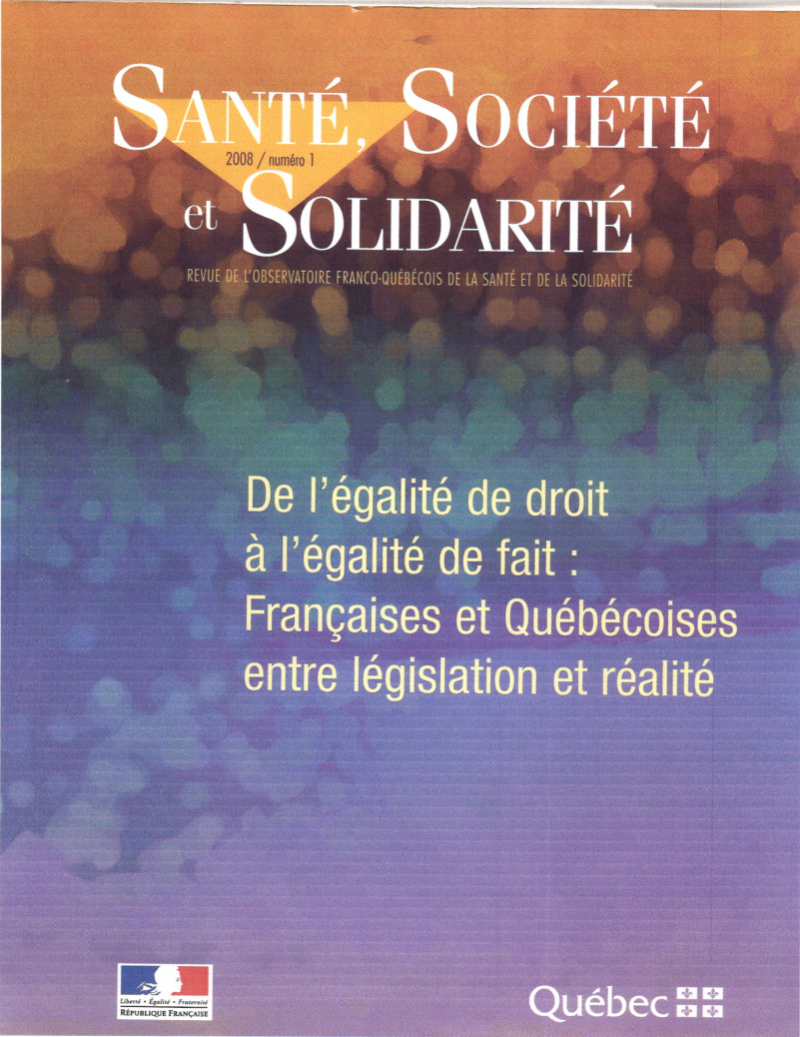Article publié dans Santé, Société, Solidarité N°1, Revue de l’observatoire Franco-Québécois de la santé et la solidarité, 2008. Voir l’article original.
Résumé :
Depuis 1974, en France, une instance gouvernementale est chargée des questions féminines : Condition féminine ou Droits des femmes. Il s’agit d’une réponse institutionnelle aux problèmes soulevés par le mouvement des femmes. D’abord sans budget, ni pouvoir réel, celle-ci n’a eu qu’un rôle symbolique : donner une image moderniste d’intérêt pour les femmes. Ses relations n’ont pas été faciles avec un mouvement des femmes alors essentiellement contestataire. Ce sont des rapports très différents, faits de connivence et de compétition qui s’instaurent à partir de 1981 avec le Ministère des Droits de la femme d’Yvette Roudy. Progressivement, à travers les alternances successives, un processus de normalisation s’établit, aboutissant à un référentiel commun et à la préférence pour le terme de parité. Pratiques administratives standardisées et distanciation avec le mouvement féministe caractérisent les institutions.
Les institutions internationales ont été un levier important pour la progression de l’égalité. Le principe à travail égal, salaire égal a été posé dès 1919 par le Traité de Versailles. Mais c’est surtout dans la Communauté européenne qu’a été constitué un ensemble cohérent de principes et de règles pour interdire les discriminations et construire l’égalité des chances, avec des outils dont il importe de se saisir.
Mouvement et institutions : des relations complexes
La France a été la première –en 1974- à mettre en place au niveau gouvernemental une instance spécialisée. Il s’agissait d’apporter une réponse institutionnelle aux problèmes soulevés par le mouvement des femmes. Le Secrétariat d’Etat « à la Condition féminine » est confié par le Président Valéry Giscard d’Estaing à Françoise Giroud. Il entend ainsi bénéficier d’une image moderniste, d’ouverture politique et d’intérêt pour les questions féminines. Le moins qu’on puisse dire c’est que les relations n’ont pas été faciles entre la Secrétaire d’Etat et le mouvement des femmes.
Le féminisme de la première vague s’adressait à l’Etat pour demander des réformes ; celui des années 1970, contestataire, affecte le plus grand dédain pour les institutions. Il ne demande rien, mais dénonce ceux qui « décident pour nous », légifèrent sur notre corps. De son côté le Secrétariat d’Etat s’attache à examiner le droit, pour identifier les séquelles inégalitaires et proposer « Cent mesures » (Bard, 2007), alors que le mouvement féministe a dépassé la question de l’égalité en droit pour se situer sur un tout autre registre. Sans budget, sans autre pouvoir que celui que le Président lui concède, sans poids politique vis à vis du gouvernement, le Secrétariat d’Etat n’a pas en charge les questions « chaudes ». C’est Simone Veil, ministre de la Santé, qui réalisera la grande réforme de la période, répondant à une forte demande sociale : la libéralisation de l’avortement.
Françoise Giroud a pourtant à son actif une loi sur l’égalité des salaires, en 1975. Celle-ci transpose une directive européenne. Mais c’est l’exemple type d’une « réforme symbolique » ; c’est-à-dire d’une politique publique destinée à prendre en compte certains problèmes sociaux, qui échoue à les résoudre effectivement (Mazur, 1995).
Avec l’élection de François Mitterrand en 1981, le rapport du mouvement féministe aux institutions change. Yvette Roudy, ministre « des Droits de la Femme » s’entoure de militantes féministes (Simone Iff, MFPF) et d’expertes de l’égalité professionnelle (Christiane Gilles ex-CGT, Claire Sutter ex CFDT). Elle attribue des subventions aux groupes qui se constituent en « association », provoquant un phénomène d’institutionnalisation dans le mouvement des femmes. Celui-ci, qui a perdu une grande part de sa dynamique, se divise sur l’attitude à adopter à l’égard de ce pouvoir, qui tend à substituer les moyens de l’administration aux forces militantes ; mais qui peut aussi faire appel à la mobilisation pour appuyer son rapport de forces au sein du gouvernement. Les relations sont faites désormais de connivence et de compétition (Picq, 1983).
L’action du Ministère Roudy en faveur des droits des femmes a été beaucoup plus déterminée que celle du Secrétariat d’Etat précédent, surtout dans sa première période ; c’est aussi qu’il était soutenu par les exigences européennes. La France devait transposer les directives de 1975 et 1976 sur l’égalité de rémunération et l’égalité de traitement.
A partir de 1986 les administrations vont se succéder au rythme des alternances. Tour à tour Ministère, Secrétariat d’Etat ou Délégation, à la Condition féminine ou aux Droits des femmes, rattaché au ministère des Affaires sociales, à celui de l’Economie ou au Premier Ministre… celles-ci expriment la différence de conception quant au rôle des femmes entre la gauche qui met en avant les Droits, l’Egalité, le Travail des femmes… et la droite qui se représente toujours plus ou moins les femmes en tant que mères. Mais il semble que progressivement les différences s’estompent et qu’un référentiel commun se construise.
Entre 1993 et 1995, les droits des femmes sont confiés à Simone Veil, Ministre d’Etat, ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville. La reconnaissance des féministes à l’égard de Simone Veil, depuis la loi sur l’interruption volontaire de grossesse, transcende le clivage Droite / Gauche. La continuité d’ailleurs se manifeste dans le bulletin « Droit des femmes », édité par le Service des Droits des femmes, qui continue d’une période à l’autre.
Au contraire l’alternance de 1995 marque une rupture entre la politique gouvernementale et le mouvement féministe, qui trouve une nouvelle jeunesse dans cette opposition. Dès le projet de loi d’amnistie, la CADAC (Coordination des associations pour le droit à l’avortement et à la contraception) voit ses efforts (qui avaient été soutenus par le vote de la loi Néiertz instaurant le délit d’entrave à l’IVG) remis en cause, et réussit à mobiliser un milieu féministe assoupi. Quant à la question des femmes dans le nouveau dispositif gouvernemental elle est définie par l’objectif de « Solidarité entre les générations », renvoyant les femmes à une mission traditionnelle qu’on croyait dépassée. Bien au-delà des cercles militants, la défense des « Droits des femmes » devient l’objet d’une vaste mobilisation populaire. La manifestation du 25 novembre 1995 rassemble dans un nouveau front anti-gouvernemental partis d’opposition, syndicats, associations diverses. Les grandes grèves de novembre -décembre qui la suivent de près donneront l’image d’une l’alliance, qui avait échoué dans les années 70, entre féminisme et mouvement social.
La dissolution de 1997 amène une cohabitation qui se révèle favorable à l’avancée des droits des femmes. Une sorte de compétition se développe entre le Président de la République et le Premier Ministre, pour lesquels la féminisation de la vie politique est un facteur de modernisation. Le mouvement pour la parité, qui sait profiter de ce contexte, obtient un succès inespéré. L’Observatoire de la parité, installé par le gouvernement Juppé en 1995, redynamisé en 1997 par le gouvernement Jospin, devient une instance efficace d’analyse et de préparation des débats parlementaires qui aboutiront à la révision constitutionnelle de 1999 et aux lois électorales qui « favorisent l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats et fonctions électorales ».
Le terme de parité, bien qu’il ne soit inscrit ni dans la constitution, ni dans la loi, l’a emporté dans le discours politique comme dans l’opinion publique. C’est lui, avec l’égalité professionnelle, qui en 2002 nomme la mission de la nouvelle ministre : Nicole Ameline. Plus tard Catherine Vautrin sera ministre délégué à la Cohésion sociale et à la Parité (Dauphin, 2006).
Est-ce le mouvement pour la parité qui a permis de transcender l’opposition droite gauche concernant les femmes ? Cet objectif a été l’occasion d’un combat où associations et regroupements de droite comme de gauche se sont retrouvés, où élues et militantes de droite et de gauche ont uni leurs forces. Cette alliance se retrouve aussi dans les deux chambres du Parlement et au Conseil économique et social, où des Délégations aux droits des femmes et à l’égalité des chances rassemblent des élu-e-s concernées appartenant aux divers partis.
Il semble qu’un processus de normalisation ait abouti à un corpus de connaissances, d’analyses, de définitions d’objectifs communs ; un référentiel commun, tel qu’il est difficile de dater les différentes publications du Service des droits des femmes ou de repérer les nuances entre des programmes comme par exemple la Convention interministérielle pour l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans l’éducation, signée en 2000 et prolongée à plusieurs reprises et la Charte de l’égalité entre les hommes et les femmes proclamée par Nicole Ameline. En même temps les pratiques administratives se sont standardisées, technicisées avec l’encouragement au gender mainstreaming. C’est la même expertise, qui puise dans la recherche sur les femmes et le genre, qui structure la vision des politiques, tandis que se marque la distanciation avec le mouvement féministe (Dauphin, 2006)
L’influence internationale :
Les principes et exigences internationales ont été un levier important pour la progression de l’égalité. Dès 1919, le Traité de Versailles posait le principe à travail égal, salaire égal. La Convention 100 de l’OIT, ratifiée par la France en 1952, définit le travail de même valeur. Le Traité de Rome, en 1957 pose l’exigence d’égalité entre les salaires masculins et féminins dans son article 119. Il s’agissait alors, à la demande de la France, qui avait aboli la double échelle des salaires en 1946 avec le Décret Ambroise Croizat, d’éviter une concurrence faussée avec les pays qui n’avaient pas établi le principe de l’égalité des salaires pour un travail de même valeur. Longtemps resté ineffectif, l’article 119 a été le fondement des progrès à partir de 1975. Dans le contexte de renouveau du féminisme dans l’ensemble des pays occidentaux et de proclamation par l’ONU d’une « année internationale de la femme », de nouvelles directives sont élaborées par la Commission et adoptées par le Conseil. C’est pour transposer celles-ci dans le droit national que Françoise Giroud en 1975 et Yvette Roudy en 1982 ont fait adopter les lois d’égalité. De même l’égalité salariale votée en 2006, que le Président de la République a présenté comme une volonté de sa part, résulte d’une obligation communautaire. La Cour de Justice des Communautés européennes, qui peut être saisie directement par les individu-e-s concernées, s’est révélée très inventive dans sa jurisprudence, avec le concept de « discrimination indirecte » et l’aménagement de la charge de la preuve…
En juillet 2006, les sept directives concernant l’égalité ont été refondues dans une règle unique. Les Etats ont l’obligation de mettre en place un organisme national chargé de promouvoir l’égalité de traitement entre tous et de lutter contre les discriminations (En France la HALDE). La Communauté européenne a constitué un ensemble cohérent de principes et de règles pour interdire les discriminations et construire l’égalité des chances, notamment entre les femmes et les hommes.
Reste à se saisir de ces outils…
Françoise Picq
IRISES Université Paris Dauphine
Références bibliographiques :
Bard, C., (2007), « Cent mesures pour les femmes », in Berstein, J-F., Les années Giscard. Les réformes de société, Paris, Armand Colin.
Dauphin, S., (2006), « L’élaboration des politiques d’égalité (France/Canada) », Cahiers du Genre, hors série, « Féminisme(s), Recompositions et mutations.
Mazur, A. (1995), Gender Bias and the State, Symbolic Reform at Work in Fifth Republic France, Pittsburg and London, University of Pittsburg Press, 321.
Picq, F. (1983), « Droits de la femmes ou droits des femmes, le Ministère, ses lois et le sexisme », La Revue d’en face, n°14, automne.